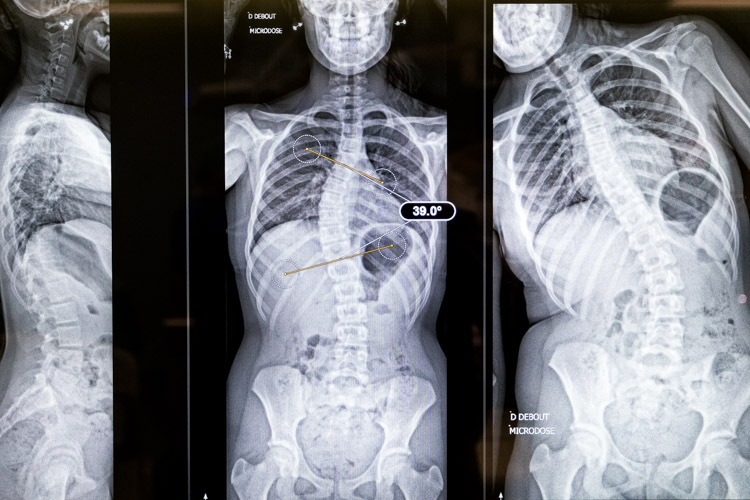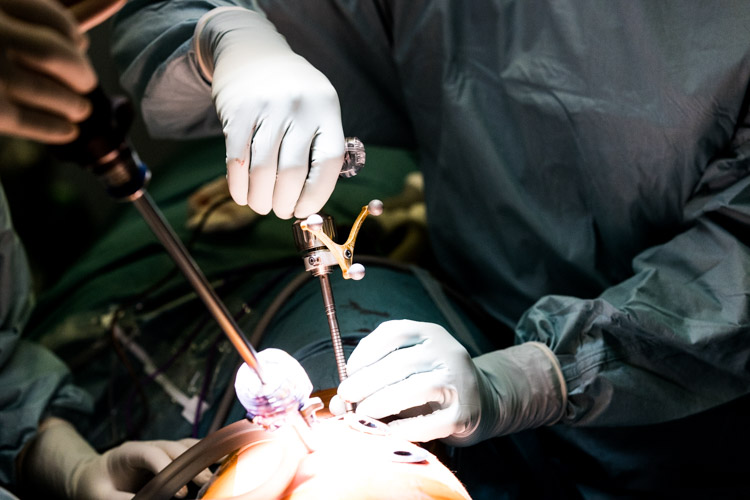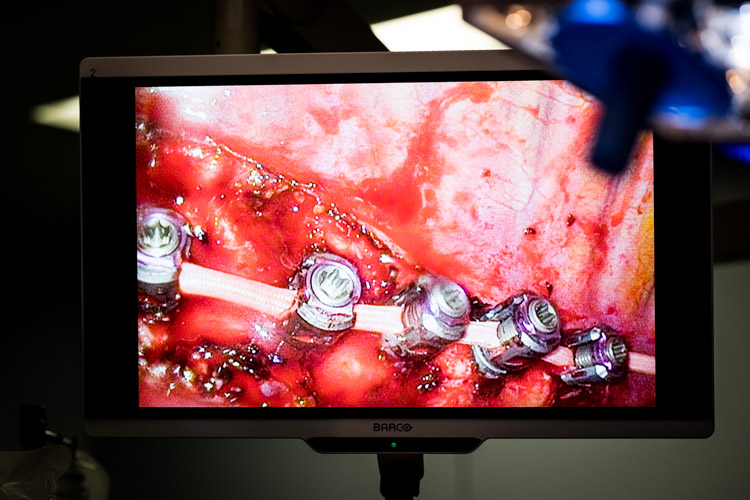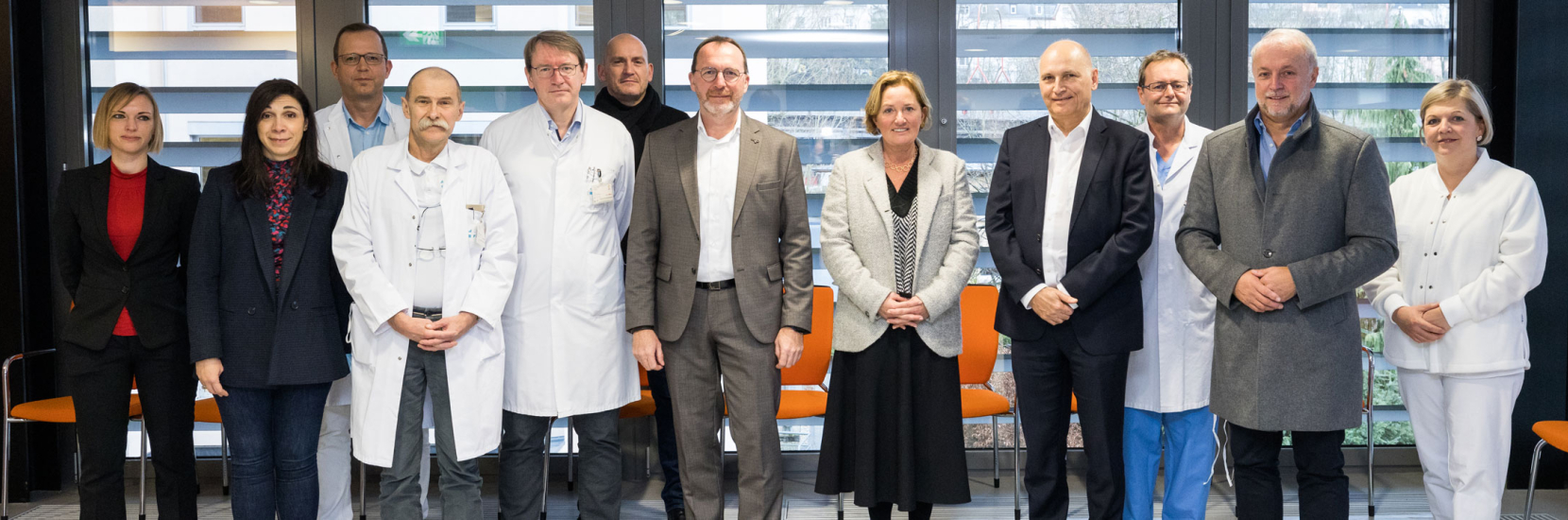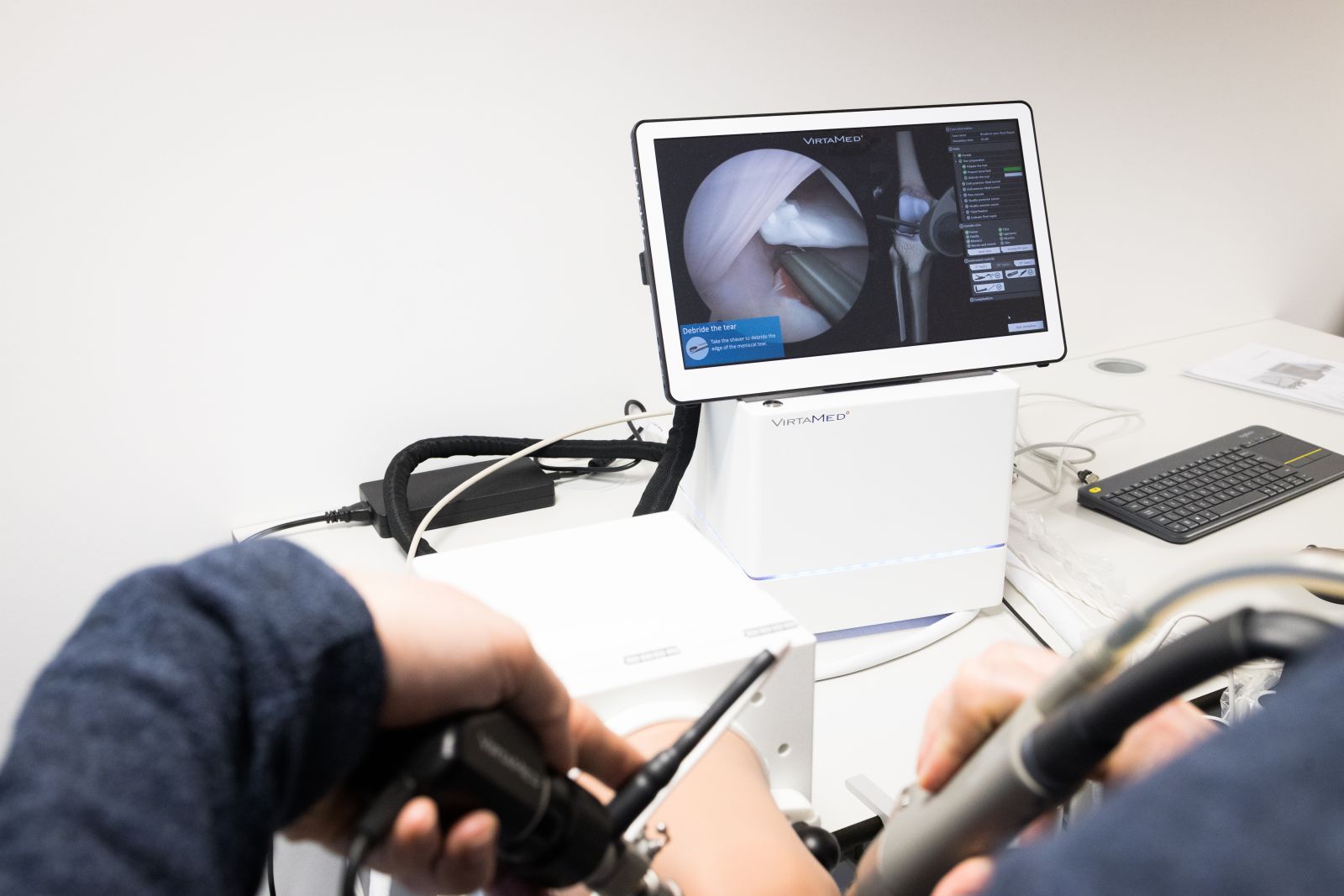Le 28 février 2023, de 10h00 à 16h30, amphithéâtre du CHL
PROGRAMME
Conférences TOUS PUBLIC de 10h00 à 12h30, amphithéâtre du CHL.
Parcours de soins
MODÉRATEURS :
- Francesca POLONI, Chef du service Coordination des Plans Nationaux, Direction de la Santé
- Daniela COLLAS, Directrice des Soins, CHL
10h00 :
- Mot de bienvenue - Direction du CHL - Dr M. Goergen, Directrice Médicale
- Vidéomessage de soutien de Mme P. LENERT, Ministre de la santé
- Introduction - ministère de la Santé - Mme F. Poloni
10h15 : Présentation filière Mucoviscidose - Mme C. Eisele (CHL)
10h35 : Présentation filière Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) - Dr G. Wirtz / Dr Ph. Kerschen / Dr M. Leches (CHL)
10h55 : Présentation filière uro-digestive pédiatrique - Dr C. Gomes / Dr O. Niel / Dr E. Pizon (CHL)
11h15 : Présentation Cellule Coordination Nationale - Mme G. Crohin (ALAN)
11h35 : Présentation Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) en Génétique - Dr A. Sorlin (LNS) / Mme A. Bernassola (CHL)
11h55 : Témoignages et messages de patients - Sh. Feider-Rohen (ALAN) / J. Glesener
12h15 : Questions et discussion
12h30 : COLLATION ET VISITE LIBRE / MEET THE EXPERT
Conférences "UP-TO-DATE" pour PROFESSIONS DE SANTÉ de 13h30 à 16h30, amphithéâtre du CHL.
MODÉRATEURS :
- Dr Jos EVEN, Président de la CNMR
- Dr Alessia POCHESCI (CER), Médecin responsable du centre de recherche clinique du CHL
13h30 : Présentation du Hub ERN (European Reference Networks) - Mme A. Bernassola (CHL)
13h40 : L'ERN ENDO en Endocrinologie Pédiatrique - Dr U. Schierloh / Dr M. Becker (CHL)
14h00 : Le Xeroderma Pigmentosum - Dr F. Bourlond (CHL)
14h20 : L'Hypertension Artérielle Pulmonaire (HTAP) chez l'adulte - Dr G. Wirtz (CHL)
14h40 : L'Amyotrophie Spinale Infantile - Dr F. Pauly (CHL)
15h00 : La Dialyse péritonéale chez l'enfant - Dr O. Niel (CHL)
15h20 : Nouvelles approches en génétique - Dr A. Sorlin / Dr G. Jouret (LNS)
15h40 : Maladies Rares Hépatiques - Dr V. Prado (CHL)
16h00 : Prise en charge des patients (enfants et adultes) - Dr A.-M. Charatsi - Dr M. Sieren (CHL)
16h20 : Mot de clôture - Dr F. Pauly (CHL)
ATELIERS INTERACTIFS : questions autour de ..., de 13h30 à 16h00, un atelier toutes les 40 minutes. Salles R2
En parallèle des conférences, vous pouvez participer à un ou plusieurs ateliers, dans la limite des places disponibles. (Et retourner ensuite à l'amphithéâtre pour suivre les conférences.)
- Salle R2A : Atelier 1 - Gastrostomie, Peristeen®, néovessie, dialyse péritonéale de l'enfant - Dr C. Gomes / Dr O. Niel (CHL)
- Salle R2B : Atelier 2 - Les patients et la Ventilation - Mme F. Nzuangue / kiné (CHL)
- Salle R2C :
- Atelier 3 : Les enjeux de la consultation de médecine génétique - Généticien LNS
- Atelier 4 : Créons ensemble les bonnes pratiques autour de l'annonce diagnostique - Psychologue ALAN
INSCRIPTIONS
Participation gratuite, merci de vous inscrire via le formulaire d'inscription en ligne disponible ici.