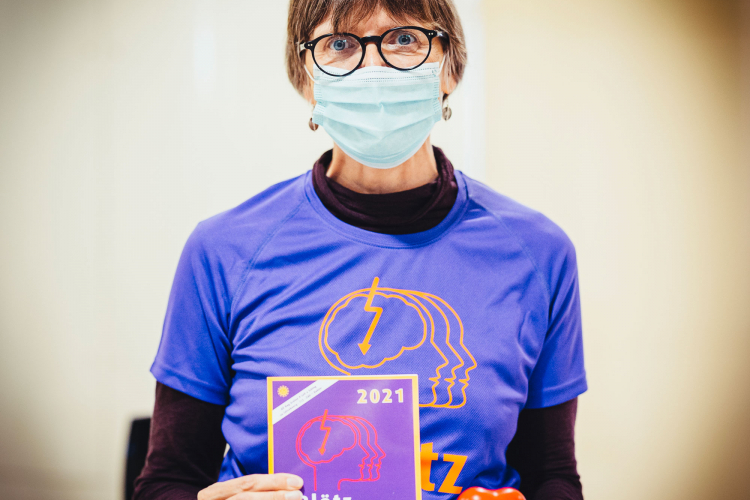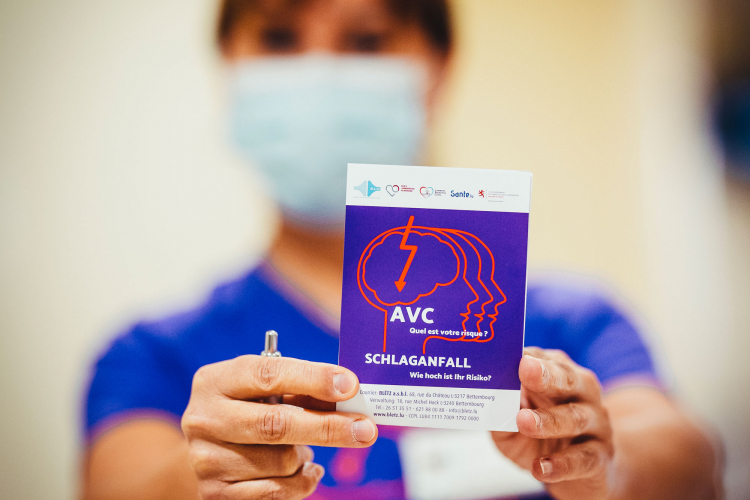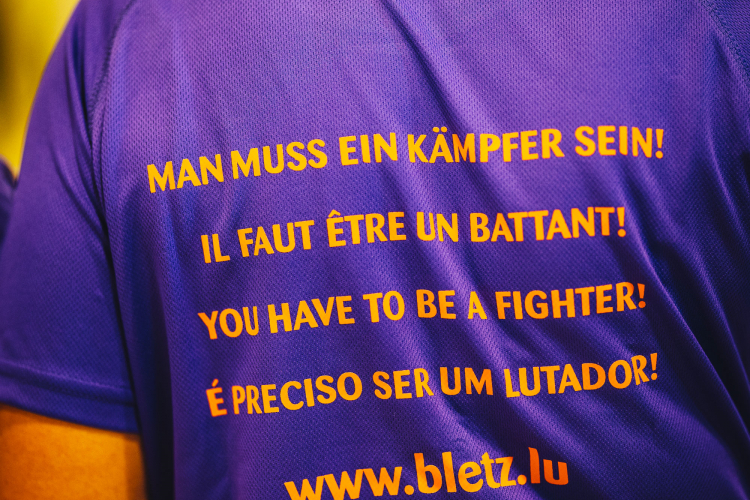SAVEZ-VOUS CE QU'EST LA CHOLESTASE GRAVIDIQUE ?
La cholestase gravidique est, comme son nom l'indique, une maladie du foie transitoire qui se déclenche chez la femme enceinte. La cholestase est une maladie dans laquelle les hépatocytes (=les cellules spécialisées du foie), laissent passer les acides biliaires dans le sang plutôt que dans la bile. En général, la cholestase gravidique se déclenche au troisième trimestre de la grossesse. Les symptômes sont en général des démangeaisons intenses sur les mains, les pieds augmentant le soir et la nuit. Elle ne doit pas être prise à la légère, car elle peut être très nocive pour le foetus.
HYGIÈNE DE VIE À DOMICILE
Il est important d'éviter tout stress ou cause d'anxiété. Écoutez votre corps et reposez-vous lorsque vous en avez besoin. Une alimentation fraîche, saine et équilibrée
est recommandée.
Le repos fait partie intégrante de votre traitement, faites attention au surmenage. Ne reprenez pas immédiatement toutes vos activités quotidiennes. Faites vous aider à la maison, si cela est possible.
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE TRAITEMENT ?
Le traitement se fait en fonction des prescriptions de votre médecin. Il faudra veiller avant votre départ à vous fournir tous les médicaments nécessaires. Nous vous donnerons avant votre sortie une ordonnance médicale. Le personnel médico-soignant vous expliquera comment et quand prendre vos médicaments ainsi que la surveillance nécessaire lors de la prise de ces derniers. De l'acide ursodésoxycholique peut être prescrit, car il diminue les démangeaisons et le taux d'acides biliaires.
Compte tenu des risques encourus par le foetus, les femmes enceintes touchées par la maladie doivent être surveillées de près. Des tests sanguins sont réalisés régulièrement pour évaluer la concentration en acides biliaires dans le sang. L'état de santé du bébé est également analysé grâce à des monitorings réguliers, qui permettent de connaître son rythme cardiaque et de détecter un état de stress foetal.
Pour éviter les complications maternelles et foetales, les médecins pourront envisager un déclenchement du travail avant le terme prévu.
Un suivi plus régulier sera réalisé (consultation avec votre gynécologue, contrôle cardiotocogramme (CTG), échographies, bilans sanguins...).
QUAND DEVEZ-VOUS VENIR À L'HÔPITAL ?
N'hésitez pas à consulter votre gynécologue ou venir à la maternité :
- Si vos symptômes (démangeaisons) s'aggravent ou réapparaissent.
- Si vous avez une altération de votre état général (fatigue, sensation de mal-être,…
- Si vous ne sentez moins OU plus votre bébé bouger.
En dehors de la cholestase gravidique, durant une grossesse, vous devez également consulter pour les motifs suivants :
- Lors de contractions utérines avant 36 semaines d’aménorrhée.
- Lors de contractions utérines régulières, douloureuses et qu’elles apparaissent toutes les 5 à 10 minutes pendant 1 heure.
- Lors de pertes de liquide (rosées, sanglantes, jaunes, vertes, pertes liquidiennes incolores comme de l'eau).
- Lors de pertes de sang.
- Lors de pertes vaginales malodorantes.
- Lors d'une chute ou d'un accident ayant entraîné un choc au niveau de votre ventre.
- Lors de toute altération dans votre état général. (fièvre >38°C, céphalée, douleur abdominale diffuse, hypertension artérielle,...).
- Lorsque vous êtes inquiète, quel qu’en soit le motif.
QUELLES SONT VOS RESSOURCES ?
Si vous devez vous rendre à l'hôpital et que personne de votre entourage ne peut être présent, faites appel à un membre de votre famille, un ami, un voisin et si cela n'est pas possible et que votre état le permet, vous pouvez faire appel à un taxi. Evitez les transports en commun. Si c'est urgent, faites appel à l'ambulance.
Afin de respecter le repos préconisé, n'hésitez pas à vous faire aider dans votre cercle familial ou amical si cela est possible.
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre gynécologue, votre sage-femme libérale ou bien encore la Maternité.
Réf. : Flyer Cholestase gravidique Mars 2025